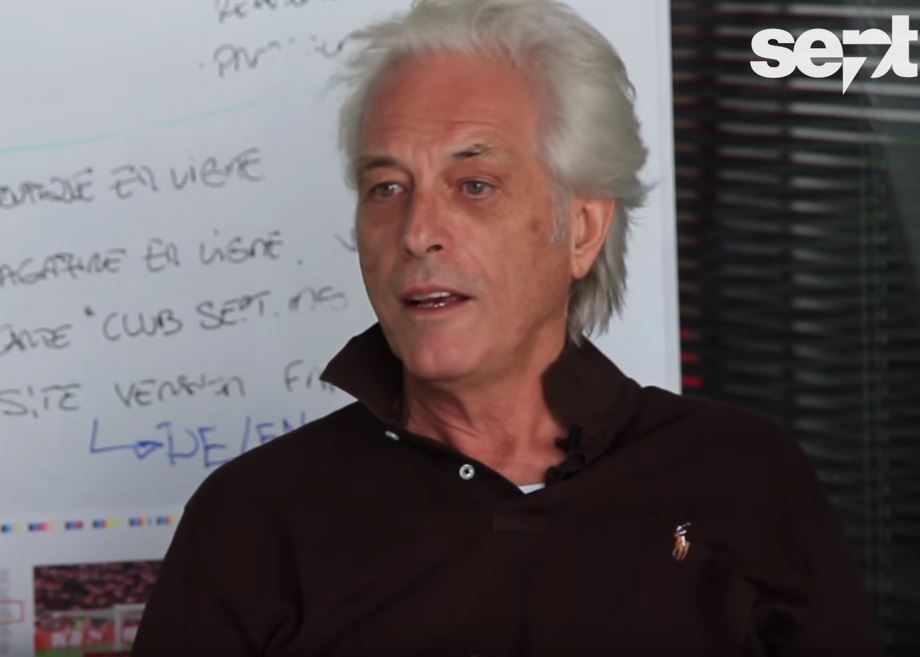Face au déclin des médias traditionnels, Christian Campiche, président d’Impressum, la plus grande organisation de journalistes de Suisse, s’inquiète, mais croit à l’avenir d’une presse métamorphosée. Journaliste, essayiste et romancier, Christian Campiche est également le fondateur du journal en ligne La Méduse. Entretien.
L’avenir de la presse en général pourrait-il être le sujet de la chronique d’une mort annoncée?
Christian Campiche: Oui mais aussi celui d’une résurrection. Nul ne sait quand celle-ci viendra véritablement mais l’on en perçoit les prémices. Pour la première année, le Washington Post est devenu bénéficiaire en 2016 grâce à sa version numérique payante. Son propriétaire, Jeff Bezos, a annoncé vouloir engager une soixantaine de journalistes en 2017.
Quel avenir pour la presse écrite, la télévision ou la radio face à la fragmentation du lectorat et au numérique par le biais du smartphone?
Sous une forme ou une autre, la presse écrite, la télévision et la radio subsisteront. La question est de savoir comment. Si la presse écrite se maintenait uniquement grâce aux magazines people, elle perdrait sa vocation citoyenne qui est d’informer dans l’intérêt de la démocratie – je serais tenté de l’écrire avec un grand D. Si la télévision et la radio ne diffusent plus que des séries, elles ne répondront plus à leur mission de service public.
Les symptômes de déliquescence sont-il les mêmes pour ces trois canaux de diffusion? Comment résister face à l’effritement de leurs audiences?
Ils souffrent des mêmes symptômes, et c’est cela qui m’inquiète. La perte de substance n’est pas seulement économique, en raison du modèle basé sur la publicité qui a fait son temps. Elle est aussi morale. Pourquoi fait-on du journalisme? Dans son préambule, la «bible des journalistes» – la Déclaration des devoirs et des droits – dit bien que «le journaliste tient pour devoir essentiel de rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et qu’elles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même». Je cite souvent cette phrase de George Orwell, qui résume tout: «Le journalisme, c’est de faire savoir ce que d’autres ne veulent pas qu’on sache. Tout le reste n’est que relations publiques».
Le journalisme ne subit-il pas une perte de sens auprès des jeunes?
Oui et non. Les jeunes sont tentés de penser que tout ce qui défile sur les réseaux sociaux est du journalisme. Or Facebook n’a rien à voir avec le journalisme, ou si peu. Le journalisme est un métier. J’aime bien le comparer aux médecins ou aux avocats qui ont leurs codes. Que dirait la population si un médecin se définissait comme tel uniquement parce qu’il surfe sur internet? Le journalisme implique le respect de règles précises, il ne s’improvise pas. Il requiert aussi un idéal, incompatible avec la dictature. Il faut du courage pour exercer ce métier. Cela dit, je constate chez beaucoup de jeunes une recherche authentique, un besoin profond de croire dans le journalisme. Je n’ai pas de solution miracle à proposer pour convaincre les jeunes de l’utilité du journalisme, mais je suis convaincu que l’une des clefs réside à l’école.
Comment l’école peut-elle intervenir?
Les enseignants ont une mission essentielle: il leur incombe de traduire en enjeu citoyen la nécessité du journalisme. D’abord aider les élèves à se situer dans la société. L’interrogation existentielle des journalistes – pour qui, pour quoi je fais ce métier? –, ils doivent se la poser pour eux: pour qui, pour quoi je suis sur ces bancs d’école, quel est le but de mon existence? Si on leur explique que leur avenir est d’abord dans leur village ou la ville où ils habitent et paient leurs impôts, plutôt que sur une piste des Montagnes Rocheuses où les entraîne leur 300e ami Facebook, ils comprendront peut-être quel est leur rôle. Et par voie de conséquence, ils sauront peut-être à quoi sert le journalisme professionnel. Finalement le journalisme est un symbole de l’éducation que reçoivent les jeunes. Le respect de l’information, sa compréhension, participent de la même logique que l’harmonie au sein de la famille, le respect que les enfants éprouvent envers ceux qui les élèvent.
L’approche de la vérité est-elle encore possible?
Je ne sais pas si la «vérité» est le vrai problème. C’est comme la qualité, une notion que tout le monde revendique, à commencer par les journaux gratuits, et pas toujours à tort, d’ailleurs, ce qui est quand même un paradoxe. Je ne connais pas d’éditeur qui ne dise pas que ses titres font de la qualité. J’ai beaucoup plus de respect pour un journal qui avoue ses orientations partisanes qu’en un autre qui prétend faire de l’information selon des critères soi-disant «neutres». Il y a une dimension très hypocrite dans cette dernière approche. J’y vois même un danger de manipulation au service d’intérêts occultes ou dictatoriaux.
Selon Philippe Amez-Droz, chargé de cours à l’Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme de l’Université de Genève, «la qualité, c’est d’abord un produit qui sert son public. Un 20 minutes est un produit de qualité car il répond à une demande et réussit à atteindre sa cible». Etes-vous d’accord avec cette affirmation?
La «cible» est un mot utilisé dans le jargon du marketing. Or le journaliste doit veiller au contraire à séparer la publicité du rédactionnel, comme le lui impose la Déclaration des devoirs. Quand ils visitent les rédactions, les responsables de la publicité n’ont qu’une idée en tête, c’est d’inculquer la notion d’«imagination». En d’autres termes, ils trouveraient épatant que les journalistes écrivent dans une optique qui attire les annonceurs, avec des sujets faits sur mesure, comme les nouvelles tendances dans les stations de ski, qui permettent de draguer les pubs des magasins de sport, pour ne donner qu’un exemple.
«Nous continuerons à faire mieux avec moins d’effectifs», a affirmé Pierre Ruetschi, rédacteur en chef de la Tribune de Genève, dans Le Courrier. Est-ce possible?
Chaque plume en moins est une perte pour l’identité d’un titre. Au four et au moulin, les journalistes confinés dans une newsroom doivent jongler avec les articles et les prestations, d’abord en ligne, ensuite peut-être sur les ondes, enfin pour la version papier du lendemain. Comment faire un travail approfondi de cette manière? Surtout si en plus il n’y a qu’un téléphone pour dix personnes! Finalement, il faudrait demander au lecteur lambda ce qu’il en pense. La population a de plus en plus de peine à se fidéliser pour son journal «historique». Je suis sidéré par la perte de substance dans le contenu de beaucoup de quotidiens. Comme je le disais tout à l’heure, le plus grave est la perte du sens critique qui rejoint quelque part le sens civique.
Faut-il que les grands groupes de presse bénéficient des avantages d’une plateforme dédiée à la création d’articles, subventionnée notamment par l’Etat?
En Suisse, il n’y a pas d’aide directe à la presse, comme en France ou dans les pays scandinaves. Une ébauche de débat se fait jour, un chercheur fribourgeois a rendu récemment un rapport favorable à l’aide directe aux journaux, qu’ils soient sur papier ou en ligne. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. De manière incompréhensible, le consensus parlementaire est allergique à toute aide directe, lui préférant l’aide indirecte, les rabais postaux aux «petits» tirages. L’objet ici, ce ne sont pas les grands groupes de presse dont certains sont cotés en bourse. Mais une aide directe serait précieuse pour de nombreux titres naissants ou alternatifs. Après tout, la SSR et les radios privées bénéficient de la redevance et ne se plaignent pas d’une intrusion de l’Etat dans les contenus rédactionnels. Le lecteur serait aussi gagnant, car l’enjeu est bien la diversité de la presse.
Ne faudrait-il pas bannir toute idée de soutien aux journaux ou médias par la publicité comme le font Le Canard enchaîné ou, dans une moindre mesure, Le Courrier?
L’information «non conformiste», via notamment les réseaux sociaux, est accessible à toutes et à tous car elle n’est pas forcément payante. Elle suit un modèle économique basé sur les dons et le financement participatif. Je respecte et j’admire le modèle du Canard ou du Courrier. Mais ils ne vivent pas de la même manière. Le premier, véritable miracle de l’édition, offre des salaires très enviables à ses journalistes. Le second peine à boucler ses fins d’année. Un autre exemple suisse digne d’admiration est le satirique Vigousse qui vit sans publicité.
Que pensez-vous de l’initiative Médias pour tous, qui projette de mêler public et privé pour les soutenir?
Médias pour tous ne se bat pas seulement pour le service public, mais imagine un soutien par financement étatique du journalisme d’investigation dans la presse écrite. Vous n’êtes pas sans savoir que les éditeurs de la presse écrite ont pris en grippe l’accord conclu entre Ringier et la SSR. Ils y voient une trahison de l’éditeur zurichois à qui ils reprochent une sorte de concurrence déloyale dans la recherche de nouveaux espaces publicitaires. En ce sens, Médias pour tous est une initiative intelligente car elle sort du simple cadre corporatif de la SSR. Elle a aussi ceci d’intéressant qu’elle émane de cinéastes et d’artistes, des milieux qui ne sont pas à proprement parler journalistiques. Ce pedigree augmente sa crédibilité.
Et si le journalisme cessait d’exister?
Il faudrait le réinventer. Le monde du journalisme est loin d’être parfait. Il comporte aussi ses parts d’ombre. Mais un monde sans journalistes professionnels serait un monde sans repères. Or l’humanité, la jeunesse tout particulièrement, a besoin de repères, sinon elle bascule dans le chaos.